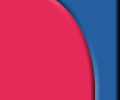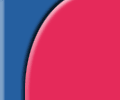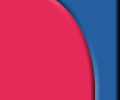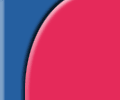Nous avons l’immense regret d’annoncer, chères lectrices, chers
lecteurs, la disparition mystérieuse et inénarrable de notre
hardi collaborateur Seb Patry, durant une expédition en Antarctique...
Les derniers témoins l’auraient aperçu, en train de surnager,
parmi les ours polaires, le long de la banquise, au large de l’Île
de la Reine-Marie... Les recherches, menées depuis le chalutier
Jesús de la Soledad par l’ex-commandant Pablo Escapar, renégat
mexicain en cavale, ont simplement permi de retrouver quelques ossements
longuement mastiqués par les pingouins. Pourtant, le rapport préliminaire
du laboratoire d’autopsies de Santiago (Chili) n’est point concluant quant
au propriétaire (présumé) de ces vestiges humains.
David Pêle-Mêle et Junior se sont rendus à Trinidad
et Tobago pour y attendre le chalutier funeste. Pablo Escapar était
chargé le leur remettre le certificat de décès, et
il en a profité pour demander sournoisement asile politique à
Ma Commune Légère. Sur le moment, David Pêle-Mêle,
en larmes, et qui s’était soulé avec du rhum local, a accepté
sans discuter... et Escapar avait tout enregistré sur bande audio,
faisant en sorte qu’il n’y ait plus de dédit possible devant le
tribunal de l’Amirauté, lequel juge toutes les causes relatives
à la haute mer ou à pas loin d’où il y a de l’eau,
sauf le Lac des Castors. Aussitôt l’ex-commandant Escapar a enrôlé
son Second officier, Vicente Lassombras, aussi appelé Vincent. Ensemble,
ils ont volé un catamaran (usagé), coulé leur ancien
chalutier (encore plus usagé), et ils sont reparti en vadrouille
pour notre compte... Précipité, hein? C’est comme ça
que ça se passe chez les pirates.
Nous avons l’immense regret d’annoncer, chères lectrices, chers
lecteurs, la disparition mystérieuse et inénarrable de notre
hardi collaborateur Seb Patry, durant une expédition en Antarctique...
Les derniers témoins l’auraient aperçu, en train de surnager,
parmi les ours polaires, le long de la banquise, au large de l’Île
de la Reine-Marie... Les recherches, menées depuis le chalutier
Jesús de la Soledad par l’ex-commandant Pablo Escapar, renégat
mexicain en cavale, ont simplement permi de retrouver quelques ossements
longuement mastiqués par les pingouins. Pourtant, le rapport préliminaire
du laboratoire d’autopsies de Santiago (Chili) n’est point concluant quant
au propriétaire (présumé) de ces vestiges humains.
David Pêle-Mêle et Junior se sont rendus à Trinidad
et Tobago pour y attendre le chalutier funeste. Pablo Escapar était
chargé le leur remettre le certificat de décès, et
il en a profité pour demander sournoisement asile politique à
Ma Commune Légère. Sur le moment, David Pêle-Mêle,
en larmes, et qui s’était soulé avec du rhum local, a accepté
sans discuter... et Escapar avait tout enregistré sur bande audio,
faisant en sorte qu’il n’y ait plus de dédit possible devant le
tribunal de l’Amirauté, lequel juge toutes les causes relatives
à la haute mer ou à pas loin d’où il y a de l’eau,
sauf le Lac des Castors. Aussitôt l’ex-commandant Escapar a enrôlé
son Second officier, Vicente Lassombras, aussi appelé Vincent. Ensemble,
ils ont volé un catamaran (usagé), coulé leur ancien
chalutier (encore plus usagé), et ils sont reparti en vadrouille
pour notre compte... Précipité, hein? C’est comme ça
que ça se passe chez les pirates.
Voici donc le premier volet
des mésaventures de notre new compagnero Pablo Escapar, qui fait
route entre l’Égypte puis la mer Adriatique sur son catamaran-déglingue
qui n’est pas sans rappeler le vaisseau de l’ami Han Solo, avec ses ratés,
ses pannes subites, et ses baisses de courant, et ses autres menus problèmes
quotidiens. Alors si vous avez aimé les chroniques de voyage publiées
précédemment sur ce site, et où l’on voyait Seb-le-Robin-des-mers-du-Sud
louvoyer hardiment entre les bancs de coraux puis les superpétroliers
de la mer Rouge, vous ne voudrez point manquer les compte-rendus rocambolesques
de Pablo, qui rame ce mois-ci jusqu’en Italie, pour mener à terme
un voyage avorté au cours duquel, comme le disait si bien Seb, un
homme pourrait « admirer tout l’éventail de la Féminité,
des femmes-soldats érythréennes jusqu’aux monokinis italiens,
en passant par le tchador des Soudanaises ». Ça nous ouvre
l’appétit!
Une tempête
Avant toute chose, mentionnons
que la navigation en « mer Med » est, à mon sens, beaucoup
moins exotique qu’en mer Rouge. Bien sûr, les paysages sont époustouflants,
et le littoral pratiquement jonché d’Histoire plusieurs fois millénaire,
mais cela ne réussit pas à endiguer la laideur chronique
qu’apportent à ces décors une immense quantité de
bateaux de plaisance... En moyenne, il y a, en mer Rouge, un grand total
de deux cents voiliers par année, entre Djibouti et Suez; ici par
contre, les voiliers sont légion, et l’on ne pourrait même
plus les dénombrer... C’est pourquoi, afin de demeurer pertinent,
ce récit de voyage s’attardera uniquement sur les moments «
chauds » du périple.
D’abord, la traversée
depuis Port-Saïd jusqu’à la Crète était bien
entamée, lorsqu’une tempête avec des vents du nord-ouest de
vingt noeuds nous tomba dessus presque à bras raccourci. Nous étions,
alors, à moins de cinquante milles nautiques des côtes australes
de la Crète. Sur une mer aussi déchaînée, impossible
de progresser le moindrement. Nous éteignîmes les moteurs
pour se laisser aller à la dérive. Plus de quarante-huit
heures passèrent, et nous avions régressé de trente
milles, vers l’Est. Le vent, capricieux ce jour-là, décida
alors de tourner, plein Ouest, sans raison aucune... Nous mîmes les
voiles afin d’essayer de « tirer des bords » (tracking
en anglais). Avec des vents aussi puissants, avec la grand-voile et le
foc hissés hauts, notre catamaran atteignait la vitesse de sept
noeuds dans une mer houleuse à souhait: il nous fallut demeurer
dans le cockpit pour surveiller le tout: vitesse, état de voile,
et vent. Le principal danger était que la proue ne s’enfonce dans
une vague monstrueuse et ne fasse culbuter le voilier, tête première.
Après plusieurs heures à ce rythme effréné,
je descendis dans ma chambre, mais constatai que cent litres d’eau salée
environ s’étaient infiltrés dans la coque... Même problème
de l’autre côté du voilier. Évidemment la pompe électrique
était brisée et notre unique solution étaient les
éponges et le seau! L’explication de ce problème était
fort simple: le catamaran avait déjà eu de par le passé
maints « échouages » sur des bancs de coraux (voir Suakin,
au Soudan, dans Le Récit de la mer Rouge); l’intégrité
de la structure était d’ores et déjà partiellement
compromise... Et lorsqu’on navigue à pleine vitesse sur une mer
démontée, chaque vague cogne solidement sur la coque, puis,
à la longue, toutes les petites fissures se rouvrent et laissent
pénétrer l’eau. Bref, avec tous ces problèmes, nous
mîmes le cap sur la Turquie avec un vent favorable, déployâmes
le « spinacker », et en deux jours nous fûmes dans la
rade de Fethiye.

Deux tempêtes
Notre seconde tempête
fut beaucoup plus surprenante. C’était entre Naxos puis le fameux
détroit de Korinthos (Corinthe). Nous avions un vent dans le dos,
et voguions sous deux voiles. Le mauvais temps a surgi comme le diablotin
d’une boîte de farces et attrapes, et avant même qu’on eut
le temps de réagir, des vents dépassaient les trente noeuds
et le voilier s’emballait à un rythme fou. Notons au passage qu’il
manque à notre cher petit catamaran près d’un mètre
d’extension au gouvernail, sous l’eau, or à grande vitesse, donc,
il est trop court, et ne réagit plus! Nous entrions, à ce
moment, dans un golfe où récifs et écueils abondaient;
en n’ayant pas le moindre contrôle sur la trajectoire du voilier,
cela était effarant. Nous parvînmes tout de même à
retourner manuellement le catamaran nez au vent pour abaisser la grand-voile
avant qu’elle ne soit en lambeaux. Une manoeuvre similaire pour abaisser
le foc, s’avéra catastrophique. Par la faute d’une tension opérée
par les bourrasques, les mécanismes sont restés bloqués
et je n’arrivais pas à abaisser le foc. Le capitaine lâcha
alors les commandes, afin de venir me rejoindre, sur le pont avant, pour
m’aider, et ce, entre deux vagues qui s’écrasaient sur nous, et
qui menaçaient de nous envoyer par-dessus bord... Nous tirâmes
à deux, sans succès. Nous foncions directement sur les rochers...
Le capitaine est retourné à la barre. Je suis resté
seul sur le pont, couché par terre, agrippé, de toutes mes
forces, aux filins... Le foc était maintenant libre de toutes ses
amarres, et il fouettait l’air, à toute vitesse, emportant cordages
et poulies dans son va-et-vient meurtrier, de plus de soixante-dix kilomètres
à l’heure... Dans ces instants terrifiants, je me sentais tel un
petit Hobbit face à un Troll géant! J’ai réussi à
démêler un peu ce bordel, sans y laisser mes doigts sectionnés,
et nous avons finalement retendu le foc, au risque qu’il ne se déchirât
dans ce vent violent. Cette opération aura probablement duré
moins de cinq minutes, mais, pour moi, cela parût une éternité.
Nous constatâmes, d’ailleurs, par la suite, que les poulies qui fouettaient
sporadiquement le pont avaient fracassé deux hublots, à tribord
(des vitres de plusieurs centimètres d’épaisseur). Je crois
que c’est à cet instant précis que je réalisai à
quel point le danger que je venais de braver, avait été grand:
un seul de ces « coups de poulie » sur mon pauvre crâne
(qui n’a pas, lui, plusieurs centimètres d’épaisseur, sachez-le),
et celui-ci se fendait assurément, comme une pastèque, et
tout son contenu et moi-même aurions été emportés
par la prochaine vague, jusque dans les bras profonds de Poséidon.
Le lendemain de cette nuit
blanche mémorable et cauchemardesque, nous passions au large d’Athènes.
Nous n’avions plus que trente milles nautiques à tirer avant le
canal de Corinthe, lorsque, tout à coup, eh oui, un AUTRE vent fou
se leva... Cette fois, nous l’avions en plein nez! Notre progression en
fut réduite à moins d’un noeud à l’heure. Au petit
matin, le lendemain, il ne nous restait (enfin) que cinq milles à
faire... mais les fils métalliques du gouvernail lâchèrent!
Cette fois, impossible de diriger le catamaran: seule notre grand-voile,
parallèle au vent, nous permettait de garder, plus ou moins, le
cap. Nous passâmes alors plus de deux longues heures à rafistoler
sommairement cette merde de gouvernail, pour venir finalement s’ancrer,
ensuite, devant Isma, pour récupérer un peu (même beaucoup)
de sommeil en retard. Bref, mon arrivée sur le continent européen
ne se fit absolument pas en douceur comme je l’avais d’abord imaginé.
En Dalmatie
Nous arrivâmes
sans encombres à Vera Luka, le petit port d’une île de la
Dalmatie, et j’espérais que l’Adriatique soit dorénavant
un peu plus calme. Depuis Otranto j’avais dû, en effet, vider plus
de cinq cents litres d’eau de mer, à cause de ces fuites dans la
coque du Catamamerde. La veille, au large de l’Italie, une corvette rapide
des gardes-côte ritals avait failli nous emboutir (ces Italiens,
ce sont des dangers publics... autant sur terre que sur mer). Mes quarts
de garde s’avéraient de plus en plus périlleux, la nuit,
avec toute cette circulation maritime et le risque omniprésent d’êtres
percutés. J’avais vraiment hâte de prendre une douche chaude
avec de l’eau douce, puis de dormir dans un endroit sec! Nous devions demeurer
ici, à tout le moins deux jours, afin de laisser ce mauvais temps
passer, pour reprendre la mer, en direction de Pula (en Croatie), derniere
escale avant Trieste, ou, plus précisément, Montfalcone...
J’avais grand-hâte de me dévorer une grosse gelatto puis de
boire trois millions de machiatos, en lorgnant les Italienne, ces reines
de l’élégance, déambuler dans les rues. En outre,
j’aurais sans doute encore un peu de temps pour faire des plongées
sous-marines à la recherche des épaves vénitiennes
et des sirènes de l’Adriatique, qui m’attendent, quelque part, dans
les profondeurs marines.
À Pula
Première journée
en Croatie après deux jours de mauvais temps en mer, et les nerfs
à vif. Mon alcoolique de capitaine avait décidé de
se dynamiter la tronche avec les liqueurs locales, et il était hors
de contrôle. À terre habituellement, lors d’escales, il ne
consomme que de la bière (un vrai bon Bavarois, quoi), mais pas
cette fois-ci... Il devînt cramoisi. Boursouflé. À
l’effigie de l’une de ces tomates italiennes. Et il tentait de communiquer
avec les pauvres Croates effarouchés, avec autant de succès
que moi, lorsque je tente de causer finlandais! Tellement bourré
qu’il faisait peur aux mômes, sur la rue. J’avais honte au point
de marcher une bonne vingtaine de mètres devant lui, tout en prétendant
ne point le connaître et ne pas du tout savoir qui il était.
À part cela,
notre voilier nécessitait de plus en plus de soins; même dans
un mouillage calme, il prenait l’eau comme pas un! Ma cabine la nuit était
un charmant petit ruisseau, et mon lit était une grande éponge
humide: un lit d’eau, au sens propre du terme. Quel luxe! Je m’ennuyais
ferme de la mer Rouge, et de son climat sec. Mes os commençaient
à geindre sérieusement de ce trop-plein d’humidité...
Par contre, et fort heureusement, je n’avais plus honte du catamaran, comme
auparavant. Ici, les flottes de voiliers sont toujours impeccables, super
modernes, et bien entretenues. Lorsque nous entrions dans un nouveau port,
les Brits sortaient de leurs cabines climatisées, pour dévisager
notre épave flottante, avec son dinghy à moitié dégonflé,
son foc déchiré, ses flotteurs envahis de coquillages, puis
d’algues vertes. L’on faisait vraiment figure de terroristes. Les autres
embarcations s’écartaient de notre chemin afin de nous céder
le passage! Car ils avaient un peu peur de nous. Tous craignaient d’être,
brusquement, victimes d’abordage, ou pire encore! En mer Med, la majeure
partie des voiliers sert uniquement en été, et ces marins
du dimanche, ayant parcouru vingt minuscules milles nautiques par semaine,
s’arrêtent dans une énorme marina « quatre étoiles
» afin de se « reposer » d’un GROS voyage. Pour les choquer,
puisqu’ils le méritaient amplement, moi, je sortais, tout frais
et dispos, le matin, faire pipi au bout du pont avant, rien que pour voir
la figure des madames british avant qu’elles ne fuient à toutes
jambes vers leurs cabines immaculées, en abandonnant sur place leurs
jolies tasses de thé congoon et leurs biscuits secs du traditionnel
English Breakfast. Ha! ha!
Dorénavant, vous pouvez
m’appeler el Navigatore del Adriatico!
Pablo
Escapar
|